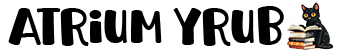Comment Kant justifie-t-il les jugements synthétiques a priori ?
Comment justifier les jugements synthétiques a priori ? Ce sera la grande question qui nous retiendra durant les quelques lignes suivantes. Le problème n’est pas celui de savoir s’ils sont vrais ou s’ils sont faux, on admet d’ailleurs que ces propositions sont vraies, mais de savoir comment les justifier. Par définition, un jugement synthétique a priori n’est pas analytique, donc on ne peut pas savoir qu’il est vrai uniquement en utilisant le sens des termes, ou en utilisant le principe de non-contradiction. Bref, le concept du prédicat n’est pas contenu dans le concept du sujet. On ne peut pas non plus justifier un tel jugement par l’expérience, puisqu’il est a priori. Les moyens traditionnels de justification utilisés pour les jugements synthétiques ne fonctionnent donc pas, de même pour les moyens utilisés pour les jugements analytiques… Comment donc justifier un jugement synthétique a priori vrai ? C’est là tout notre problème.
Une autre partie de la question se formule ainsi : Quels sont les jugements synthétiques a priori d’après Kant ? C’est une question distincte de la précédente, on peut en effet penser que Kant s’est trompé sur les jugements synthétiques a priori, mais reste que s’il y a des jugements synthétiques a priori, alors la question se pose.
Le problème est très étendu chez Kant car il pense que dans la catégorie des jugements synthétiques a priori se rangent les propositions métaphysiques, mathématiques et physiques. Les propositions métaphysiques fondamentales, les propositions mathématiques fondamentales et les propositions physiques fondamentales font donc partie des jugements synthétiques a priori selon Kant. C’est donc un domaine immense, et un… problème immense. C’est d’ailleurs pour répondre à cette difficulté que Kant publie la Critique de la raison pure. Nous allons voir que nous pouvons apporter une réponse en ce qui concerne les principes fondamentaux de la physique et des mathématiques, mais qu’en ce qui concerne la justification des principes fondamentaux de la métaphysique, le problème restera entier. La métaphysique ne pourra plus prétendre à être une connaissance et devra renoncer au titre de science. Reste que Kant sera très critiqué en ce qui concerne ses conclusions sur les propositions fondamentales physiques et mathématiques. Il ne va en effet pas de soi que les propositions mathématiques et les propositions physiques soient synthétiques (ainsi, Leibniz aurait soutenu qu’elles étaient analytiques, et ce n’aurait pas été le seul, aujourd’hui la plupart des philosophes soutiendrait la position de Leibniz).
Les principes fondamentaux de la physique
Voyons tout d’abord ce qu’il en est avec les principes fondamentaux de la physique. Prenons un exemple: “Tout événement a une cause”. C’est un principe dont les physiciens se servent, tout comme s’en sert le sens commun. Comme les physiciens s’en servent comme d’un principe méthodologique, Kant en déduit que le principe était a priori, mais pas analytique, car: Tout événement (sujet) a une cause (prédicat) ; le concept de “cause” n’est pas contenu dans le concept “événement” ! Si nous avions voulu un principe analytique par excellence, nous aurions pu proposer : “Tout effet a une cause”.
Hume soutient, dans le Traité de la nature humaine, que la négation de notre principe (“tout événement a une cause”) n’est pas contradictoire; c’est un principe non-logiquement nécessaire, mais physiquement nécessaire.
Beaucoup d’auteurs admettraient que les principes physiques soient synthétiques, mais pas qu’ils soient a priori. Après tout, rien ne dit que nous sachions que “tout événement a une cause” soit vrai ! Ayer, par exemple, dirait que c’est simplement un principe général, et qu’il n’est pas logiquement impossible que l’on trouve un jour un événement sans cause !!!
Les principes fondamentaux des mathématiques
Selon Kant, les propositions mathématiques sont aussi synthétiques, pourquoi ? Il donne l’exemple suivant: 7+5=12 (7+5 étant le sujet, et 12 le prédicat).
Pour que cette proposition soit analytique, il faudrait que le concept du prédicat soit contenu dans le concept du sujet (12 dans 7+5). Beaucoup pensent qu’il y a identité entre 7+5 et 12, mais pas Kant ! (voir ce qu’il dit à la page 41 de La Critique de la raison pure, édition PUF). Le concept du sujet ne contient rien de plus que la réunion de deux nombres en un seul, par quoi n’est pas du tout pensé ce qu’est le nombre unique qui renferme les deux autres. Le nombre 12 n’est pas contenu dans 7+5 selon Kant. Mais cela semble assez étrange, que veut-il exactement dire ? L’opération d’addition n’est pas la même chose que le principe d’analyse pour Kant ! A-t-il raison ? Avant de pouvoir répondre distinguons cinq problèmes :
1- Comment définir l’a-prioricité ? Comment définit-on une connaissance a priori ? On a déjà vu que c’est une connaissance dont la justification par l’expérience n’est ni possible ni nécessaire. C’est là une définition minimale, on peut y ajouter beaucoup de détails, par exemple la position psychologiste selon laquelle “une proposition vraie peut être connue a priori par les êtres humains si et seulement si les humains ont une constitution psychique telle qu’ils sont incapables de penser à la définition comme étant fausse”. La même proposition ne serait pas forcément connue a priori par des martiens (car ceux-ci auraient une autre psychologie que la nôtre). On peut aussi orienter la définition dans le sens du langage (par des conventions linguistiques), ou dans le sens anthropologique…
2- Comment définir l’analycité ? Voir la comparaison entre Kant et Ayer développée plus bas dans la page.
3- Est-ce que, oui ou non, toutes les propositions connues a priori sont analytiques ? Un empiriste logique répondrait par l’affirmative, alors que Kant répondra par la négative.
4- L’étendue des jugements synthétiques a priori; les propositions mathématiques sont-elles analytiques ou synthétiques ? Le problème n’étant pas de savoir si ce sont des vérités nécessaires ou non.
5- Y a-t-il des propositions à la fois nécessaires et a posteriori ? Des propositions nécessairement vraies mais connues a posteriori. La réponse habituelle est non, mais Kripke soutient que oui.
Ces cinq questions sont distinctes, mais elles ont des connexions assez étroites. Nous allons comparer plus précisément la position de Kant est celle de Ayer au sujet de l’analycité.
L’analycité: Kant et Ayer
Kant dit que les jugements analytiques sont des jugements dont le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet (nous l’avons assez répété). Nous avons déjà vu une objection d’Ayer (une proposition analytique est une proposition dont la validité dépend exclusivement du sens des symboles utilisés). Ayer voit, à la suite de Frege, que Kant donne une définition de l’analycité mais aussi des critères de celle-ci (la définition donne la nature même de la chose : par exemple: La grippe est x virus. Les critères se sont des “trucs” (la fièvre, le mal de gorge…) mais l’ensemble des critères ne donne pas la définition de la grippe). Kant a deux critères pour savoir si un jugement est analytique ou ne l’est pas :
– Critère logique: Exemple: “Tout homme est un animal”. Il faut faire l’analyse du concept du sujet (ici l’homme est un animal raisonnable) pour voir que le concept du prédicat est identique à une partie du concept du sujet. Le tout sans consulter l’expérience. En un mot, on peut savoir qu’un jugement est vrai seulement avec le principe de non-contradiction, ce qui n’est pas le cas avec un jugement synthétique. Le critère est donc le suivant: Une proposition est analytique si sa vérité peut être établie uniquement par l’application du principe de non-contradiction. Frege et Ayer sont d’accord sur ce point.
– Critère psychologique: Exemple: “7+5=12”. Kant soutient qu’il est possible de penser au concept “7+5” sans faire l’acte de penser 12.
Première remarque de Ayer
Les critères ne sont pas coextensif, ils ne marchent pas pour les mêmes propositions, ils ne se recoupent pas parce qu’une proposition peut être synthétique d’après le deuxième critère et analytique d’après le premier ! Si Kant a raison en énonçant son deuxième critère (que l’on peut penser 7+5 sans penser 12), alors “7+5=12” ne sera pas analytique ; mais qu’en est-il pour le premier critère ? Est-ce que ce sera analytique ou synthétique ? On peut savoir (donc analyser) si “7+5” n’est pas égal à 12, ce n’est pas logiquement impossible. Il y a là un gros problème. Frege et Ayer vont soutenir que c’est le critère logique qui compte, les propositions mathématiques ne sont donc pas synthétiques ! Mais pourquoi faire céder le deuxième critère ?
Deuxième remarque de Ayer
Le deuxième critère n’est pas pertinent. Voici un exemple de Frege: Nous pouvons parfaitement penser à un cube de glace sans penser que le cube a 12 arêtes ! On ne peut donc savoir si un cube de 12 arêtes est analytique ou non ! Et de même, le fait que l’on puisse penser 7+5 sans penser 12 n’est pas pertinent ! Donc, seul le critère logique compte. Kant pensait que les deux critères étaient équivalents, mais on vient de démontrer que ce n’est pas le cas. C’est donc là une importante attaque contre le système kantien. D’après le premier principe de Kant “7+5=12” est analytique, donc, selon Ayer, toutes les propositions mathématiques sont analytiques, et toutes les propositions a priori sont analytiques !