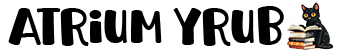HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Dans cette rubrique nous avons choisi d’étudier brièvement quelques fonctionnements de l’économie afin de mieux comprendre les mécanismes économiques sous-jacents aux événements historiques, nous aurons aussi l’occasion de nous intéresser aux entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle…
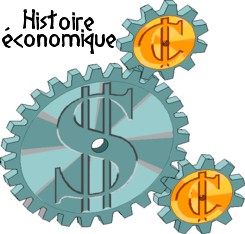
Les sociétés de commerce au secours des familles
Le système familial permettait de réunir des fonds propres, de fournir des garanties pour obtenir du crédit, de s’attacher des compétences extérieures, de faire prédominer des objectifs de très long terme sur le simple profit à court terme et donc de motiver des stratégies de développement, d’assurer une identité à l’entreprise dans le cadre du droit civil sans avoir besoin de recourir à des institutions commerciales. Mais son réseau se trouvait aisément consolidé juridiquement par la fondation de sociétés, qui élargissaient les possibilités d’association de compétences et de capitaux. Le contrat de société était ainsi complémentaire du contrat de mariage.
Les institutions
En France, le Code de commerce de 1807 consacrait un ensemble d’usages anciens en matière d’association commerciale, largement commun à toute l’Europe moderne et déjà partiellement codifié par l’ordonnance de 1673. La principale distinction était entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
La société en nom collectif: Les sociétés de personnes, formées intuitu personae, reposaient sur la confiance réciproque entre un nombre assez petit d’associés solidaires et responsables. Le modèle en était la société en nom collectif, dont les noms des principaux associés formaient la raison sociale; tous les associés étaient entièrement responsables des dettes de la société sur leur fortune personnelle. Ils participaient en général tous à la gestion selon des modalités fixées par chaque contrat, qui déterminait également la manière dont les bénéfices devaient être répartis. Le décès d’un associé, sa retraite volontaire ou son changement donnaient obligatoirement lieu à dissolution de la société et fondation d’une nouvelle société. Cette forme juridique se retrouvait presque à l’identique en Grande-Bretagne et aux États-Unis sous le nom de partnership et en Allemagne sous le nom d’offene Handelsgesellschaft (O.H.G.)
La commandite: Le Code de commerce prévoyait une variante de la société en nom collectif qui faisait une distinction entre les associés en nom collectif, qui étaient solidairement responsables, et des associés simples bailleurs de fonds qui ne pouvaient être tenus pour responsables qu’à hauteur de leurs apports, mais qui, en contrepartie de ce privilège, n’avaient pas le droit d’engager la société par un acte de gestion. Les uns étaient les commandités, les autres de simples commanditaires. La société était en nom collectif pour les premiers et en commandite pour les seconds. Toute immixtion d’un commanditaire dans la gestion entraînait automatiquement la perte de son privilège de responsabilité limitée. Leur rôle de simples bailleurs de fonds apparaissait dans le fait que leurs noms ne figuraient ni dans la raison sociale de la société ni dans l’extrait de l’acte de société déposé au greffe du Tribunal de commerce. La société en commandite avait pour fonction, dans l’esprit du législateur, de permettre à une entreprise, dont les fonds propres étaient limités dans le cadre de la société en nom collectif, de réunir des capitaux plus importants en faisant appel à des capitalistes passifs. Elle existait dans plusieurs pays du Continent européen, dans les États allemands qui s’étaient vus imposer le Code de commerce lors de l’occupation napoléonienne ou avaient adopté ensuite des codes similaires. En revanche, la société en commandite (limited partnership) n’existait pas en Grande-Bretagne; il fut question de l’introduire vers le milieu du siècle; elle ne le fut qu’en 1907. Dans certains États américains au contraire, comme dans l’État de Louisiane, qui avait subi une influence française, elle avait été imitée du Code de 1807, d’autres États l’adoptèrent jusqu’à ce qu’elle fût généralisée par l’Uniform Limited Partnership Act de 1916.
Sociétés anonymes et commandites par actions. Enfin le Code français reconnaissait les anciennes sociétés par actions sous le nom de sociétés anonymes. Puisqu’elles ne pouvaient être identifiées par les noms des associés, elles n’avaient donc pas de raison sociale et ne pouvaient être désignées que par leur objet. Elles étaient des sociétés caractérisées par la responsabilité limitée de leurs associés actionnaires, puisque seul le capital social pouvait répondre des dettes de la société. Le législateur les admettait parce qu’elles étaient indispensables au fonctionnement de l’économie, mais, soucieux de protéger les créanciers devant le danger d’irresponsabilité de la société anonyme et de maintenir la confiance sur laquelle reposait toute la vie commerciale, il les soumettait à une autorisation gouvernementale préalable. Le gouvernement qui tranchait sur les demandes d’autorisation, après avis motivé du conseil d’État, eut toujours une attitude restrictive. Entre 1807 et 1867, seulement 651 sociétés anonymes furent autorisées en France. L’État ne donnait de réponse favorable que lorsque l’intérêt public était en jeu, que l’entreprise projetée ne pouvait pas être réalisée dans le cadre d’une autre forme sociétaire et que par son activité elle détenait des actifs réels mobilisables, gages envers d’éventuels créanciers. En dehors des sociétés de capitaux héritées de l’Ancien Régime, comme Anzin, Aniche ou Saint-Gobain, les autorisations furent données en faveur de sociétés de canaux et d’assurances, puis de chemins de fer. Les sociétés anonymes industrielles étaient peu nombreuses : elles s’occupaient de mines, qui pouvaient également se constituer en sociétés civiles, de sidérurgie, de construction mécanique. Plutôt que des créations ex nihilo d’entreprises, elles résultaient de la transformation ou du regroupement de sociétés existantes qui avaient besoin d’élargir leurs capitaux sociaux et qui avaient déjà la preuve de leur bonne gestion et de leur solidité. L’évolution vers une législation plus libérale était donc inévitable, elle se fit en deux temps. La loi de 1863 rendait la fondation des sociétés anonymes libre de toute autorisation, sous le nom de société à responsabilité limitée, lorsque le capital était inférieur à 20 millions. Puis le bénéfice de cette loi fut étendu à presque toutes les sociétés anonymes (à l’exclusion des sociétés d’assurances) par la loi de 1867, qui, codifiant un ensemble de pratiques et d’institutions nées au sein des sociétés, définit pour longtemps un nouveau cadre juridique de fonctionnement : elle resta en vigueur jusqu’en 1966.
La législation anglaise des sociétés de capitaux
La société anonyme trouvait un équivalent dans la registered company with limited liability britannique. Jusqu’en 1825, les sociétés par actions (joint stock companies) avaient été soumises à des autorisations gouvernementales, distribuées, comme en France, avec parcimonie. Ensuite, si la fondation était libre, la responsabilité des actionnaires demeurait illimitée, ce qui restreignait considérablement les possibilités de drainage large des capitaux. En revanche, la société par actions avec responsabilité limitée des actionnaires resta jusqu’en 1855 toujours soumise à autorisation du Parlement ou de la Couronne. Les hommes d’affaires, qui désiraient réunir davantage de capitaux que la société en nom collectif ne le permettait utilisèrent dans la première moitié du XIXe siècle une autre forme juridique, celle de l’unincorporated company under trust law, qui s’appuyait sur une spécificité du droit britannique, le fidéicommis (trust), par lequel chaque actionnaire en tant qu’associé confiait ses apports à des mandataires (trustees) qui agissaient donc en son nom. La société n’avait pas la personnalité morale; mais elle pouvait agir par l’intermédiaire de ses trustees. Comme en France, ces formes sociétaires n’intéressaient que peu les industriels qui préféraient les private partnerships. Le lent processus de libéralisation de la législation sociétaire aboutit aux lois de 1855 et 1856, qui excluaient cependant les compagnies d’assurances, responsables de bulles spéculatives (elles purent se fonder librement en 1862). La liberté de fondation eut pour conséquence un gonflement des créations, mais les lacunes de la législation apparurent rapidement; en particulier il n’avait pas été prévu dans les exigences requises des sociétés de différences entre celles qui étaient « privées », c’est-à-dire qui ne pouvaient faire appel à l’épargne publique et n’avoir qu’un nombre limité d’actionnaires, et celles qui étaient « publiques » pour lesquelles il était justifié de demander la publicité des bilans et d’être plus exigeant en matière de réserves. Aussi certains désiraient-ils que l’on adoptât un équivalent de la commandite par actions française. L’Act de 1900 précisa la législation sociétaire, qui aboutit enfin à des solutions claires et satisfaisantes par le Companies Act de 1907. Les private companies étaient reconnues explicitement sous trois conditions (ne pas lever de capitaux dans le public, ne pas avoir plus de 50 actionnaires, limiter la transférabilité des titres dans le public) et n’étaient pas soumises aux prescriptions des autres sociétés par actions en matière de publicité et de réserves. Les public companies devaient publier leurs bilans – cette formalité était indispensable pour avoir le droit d’émettre des actions ou des obligations – et envoyer chaque année à l’administration des informations sur leur situation financière.
Le droit allemand
La Rhénanie avait adopté les codes napoléoniens, mais dans le reste de la Prusse, il n’y eut pas à proprement parler de législation des sociétés par actions jusqu’en 1843, où elles furent légalement reconnues pour permettre la construction ferroviaire. La libre fondation des sociétés anonymes ne fut néanmoins pas permise en Prusse avant 1870. La loi d’Empire de 1884 pouvait apparaître comme rigoureuse dans ses exigences, et très originale par rapport aux législations des pays voisins. Elle prévoyait un processus de fondation en deux temps. La constitution de la société, dont les actions devaient être libérées du quart, par les actionnaires, donnait lieu à un premier enregistrement. Puis, au terme de la première phase, une assemblée générale devait approuver les opérations de formation, sur lesquelles le conseil de surveillance (Aufsichtsrat) présentait un rapport. Le conseil de surveillance élisait le pouvoir exécutif, le comité directeur (Vorstand). La société n’avait plein exercice de ses droits, en particulier le droit d’émettre des titres et d’être cotée, qu’au bout d’un an. En contrepartie de ces formalités très lourdes pour de petites entreprises, fut créée en 1892 la S.A.R.L. (GmbH), que le droit français allait ensuite reprendre.
Les trois pays, qui avaient une législation à peu près identique pour les sociétés en nom collectif, différaient donc davantage en matière de sociétés par actions, soit que les principes généraux du droit ne fussent pas les mêmes, comme dans le cas de la Grande-Bretagne, soit que les structures économiques et bancaires aient exercé des influences divergentes. Mais les législations purent aussi contribuer à orienter différemment le fonctionnement des entreprises. Ainsi, le grand rôle donné au conseil de surveillance en Allemagne favorisait le développement d’un pouvoir managérial. Et la fondation en deux temps de la société conduisit en fait à la pratique de la fondation « simultanée » : les promoteurs souscrivaient toutes les actions, qu’ils pouvaient ensuite revendre par le canal d’une banque; compte tenu des besoins en capitaux, un ou plusieurs promoteurs étaient des banques, qui pouvaient ainsi porter l’entreprise jusqu’à ce que ses actions puissent être admises sur le marché financier et que des obligations puissent être émises. La loi incitait donc à développer la symbiose entre les banques et les entreprises industrielles et commerciales. Dans les trois pays, la très grande majorité des entreprises constituées en sociétés, l’étaient en nom collectif, jusqu’à ce que la loi ait mis à la disposition des petits et moyens entrepreneurs les avantages de la responsabilité limitée avec la S.A.R.L.(GmbH en Allemagne), qui remplaça pratiquement la S.N.C. Mais les commandites simples et par actions et les sociétés anonymes, ou, en dehors de France, les formes équivalentes, dont l’importance numérique était faible, représentaient une part beaucoup plus grande du total des capitaux sociaux constitués, car une forte proportion des sociétés en nom collectif, en particulier dans le commerce, n’avaient que des actifs infimes. Le développement du secteur industriel se fit en France cependant largement dans le cadre de la S.N.C. pour les industries légères et dans celui de la commandite par actions pour les industries lourdes. Ces formes recouvraient parfaitement le type de contrôle familial ou pluri-familial qui était la règle pour les entreprises du XIXe siècle. Quant aux sociétés anonymes (registered companies with limited liability en Grande-Bretagne), dont le nombre augmenta vite dès que leur création fût libre, elles permettaient des formes disséminées de la propriété de l’entreprise, avec une disjonction entre sa propriété et l’exercice du pouvoir. Mais elles recouvraient également, avant 1914, le plus souvent, les mêmes types de contrôle familial.
La société en nom collectif : un instrument à usages multiples
L’acte de constitution de société venait souvent consacrer une association de fait, fonctionnant depuis un certain temps, entre plusieurs entrepreneurs ou commerçants ou plusieurs membres d’une même famille. L’objectif de la mise en société était d’allier des capitaux ou des compétences identiques afin de former une entreprise plus puissante ou bien de combiner des compétences complémentaires, dans le cadre d’une famille ou entre personnes de familles différentes.
La commandite : l’instrument majeur de drainage des capitaux en France
La commandite était, selon l’esprit du législateur, une variante de la société en nom collectif puisqu’elle ouvrait la possibilité d’adjoindre aux associés en nom collectif des associés passifs, non responsables. C’était l’esprit de beaucoup de commandites simples dans lesquelles les commanditaires détenaient des parts non cessibles, sans modification de l’acte de société. Dans les secteurs où les besoins en capitaux étaient importants sans être considérables, mais où l’activité était risquée, cette forme conserva longtemps ses avantages. Elle permettait aussi de trouver provisoirement de l’argent sans avoir à mettre un banquier dans le secret des affaires ou à donner à un quelconque créancier un pouvoir sur l’entreprise. Les commanditaires s’engageaient parfois à fournir leur apport non pas lors de la constitution de la société, mais en cas de besoin. La mise en société palliait l’absence d’instrument spécifique de crédit à moyen terme. La commandite intéressait également les capitalistes qui désiraient placer leurs capitaux à moyen ou long terme, en profitant d’un rendement important (5 % d’intérêt statutaire plus une part des bénéfices) sans tomber sous le coup du délit d’usure, en un temps où les autres opportunités de placements étaient limitées au foncier, à l’immobilier, à la rente et aux valeurs ferroviaires. La commandite par actions avait comme avantage pour le commanditaire la négociabilité de son placement. Dans la banque, la sidérurgie, la papeterie, l’industrie minière, la chimie, la commandite par actions permit de drainer d’importants capitaux que quelques réseaux familiaux, aussi riches qu’ils étaient, ne pouvaient réunir. Pour une entreprise de type familial, elle possédait à la fois les avantages de la société en nom collectif et ceux de la société anonyme. En effet, elle garantissait le maintien du pouvoir de décision dans les mains du ou des gérants qui ne pouvaient guère être écartés par des changements de majorité. Elle maintenait le secret des affaires, dans la mesure où la comptabilité n’était soumise à aucune publicité. En revanche, elle permettait de réunir une masse considérable de capitaux sous forme d’actions, qui pouvaient également être cotés en Bourse, ou d’obligations. Il s’agissait donc moins de réunir les épargnes d’un grand nombre d’actionnaires que de recourir au soutien financier de quelques très gros prêteurs, familles bancaires, industrielles ou foncières. A partir des années 1850 en revanche, la hausse des besoins d’investissement tendit à entraîner une politique de drainage plus large, qui conduisit à diviser la valeur nominale des actions, à faire des augmentations de capital, à émettre des emprunts obligataires, sans cependant mettre en danger le contrôle de l’entreprise par les gérants.
La société anonyme et le pouvoir familial
Les sociétés anonymes autorisées avant 1867 étaient très grosses, leur capital social moyen était de l’ordre de 9 millions. Elles n’étaient pas des entreprises à base familiale. Les milieux industriels et commerçants n’avaient souhaité leur libéralisation, ni en France, ni en Grande-Bretagne, car ils considéraient que la totale responsabilité était le gage des relations de confiance dans les affaires. En France, ce furent les milieux financiers qui firent pression sur le gouvernement afin de pouvoir fonder des banques en sociétés anonymes. En Grande-Bretagne, la campagne fut menée par les milieux de la City et par les Christian Socialists désireux d’ouvrir de nouvelles possibilités de placements pour l’épargne des classes moyennes. En Allemagne au contraire, les industriels poussèrent à la libéralisation parce que l’épargne accumulée était plus faible et le recours à un drainage large des capitaux plus nécessaire. La forme de la société anonyme ne présentait pas, par elle-même, le danger, pour une famille, de perdre le contrôle de l’entreprise par un changement de majorité des actionnaires qui n’était pas possible si les actions ne faisaient pas l’objet de transactions. Or, en France, en 1870, en dehors des sociétés de transports (chemins de fer, navigation), de gaz, de banques et d’assurances, les actions de 87 sociétés seulement étaient habituellement cotées sur les marchés boursiers français. En 1913 encore, moins d’un millier de sociétés françaises étaient cotées sur les divers marchés financiers français, sur un total de l’ordre de quelque 10 000 sociétés actionnées : les plus grandes en général. Pour les autres, les actions étaient réparties dans des groupes étroits d’actionnaires, qui, lorsqu’ils désiraient vendre leurs titres, les proposaient en priorité à leurs proches. A ce vigoureux capitalisme familial, qui avait su utiliser toutes les ressources offertes par la loi, pour trouver des ressources financières et consolider son pouvoir, se superposait un grand capitalisme plus anonyme, auquel les compagnies d’assurances, celles de chemins de fer et les banques avaient ouvert une voie, qu’empruntaient désormais les grandes entreprises nées dans les secteurs nouveaux de la seconde industrialisation. La forme de la société anonyme leur permettait de recourir à des instruments de financement beaucoup plus variés, au travers des banques et du marché financier.
On ne peut identifier la vie d’une entreprise à celle d’une forme sociétaire qu’elle a utilisée et fonder sur une statistique des sociétés une « démographie » des entreprises. Dans son histoire, une entreprise put emprunter successivement différentes formes juridiques, selon sa logique propre de développement ou selon l’évolution des marchés et des techniques du secteur qui était le sien.