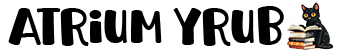L’empirisme relatif de Quine
Quine est sans doute le philosophe du XXe siècle qui a poussé le plus loin la critique de l’empirisme, tout en restant empiriste. Ce qu’il propose c’est un « empirisme sans les dogmes ». Sa contribution est donc d’abord essentiellement critique. Quine refuse l’empirisme logique, en particulier tel qu’il a pu être défendu par Carnap.
Nous avons vu que, pour Quine, l’analyse (au sens opératoire) est une remontée sémantique dont chaque pas est synthétique en ce qu’il procède par une généralisation oblique faisant référence à un univers extralinguistique dans la construction même des énoncés. C’est pourquoi la logique n’est pas vraie indépendamment des choses; elle est vraie de toutes choses: «Il est donc trivial de dire que les vérités de la logique sont vraies de n’importe quelle circonstance qu’il nous plaira de nommer: le langage, le monde, n’importe quoi» (Quine, Philosophy of Logic, p.97).
C’est par sa puissance d’universalité que la logique acquiert une priorité systématique qui nous donne le sentiment d’une nécessité a priori. Évoquant les positions de Carnap et de Wittgenstein, Quine écrit: «Nous avons noté [chez certains auteurs] la tendance à imaginer entre la logique et le langage un lien plus étroit que celui auquel nous pouvions donner un sens acceptable, à savoir la doctrine linguistique de la vérité logique, l’idée que la logique est analytique» (ibid., p.97). La logique n’est pas purement analytique. Pour Quine comme pour Kant, toute connaissance véritable est synthétique, sauf que les deux philosophes ne conçoivent pas de la même manière la distinction entre l’a priori et l’a posteriori.
L’apriorisme kantien est fondé, comme on l’a vu, sur un idéal de perfection assurant l’infaillibilité de la raison; les nécessités a priori sont irréformables. Quine admet des différences de degré dans l’importance systématique que nous accordons à certains énoncés de la logique, des mathématiques ou de la physique, dans la mesure où nous les tenons pour vrais en toutes circonstances, quoi qu’il advienne (come what may, suivant la formule de Lewis), mais rien ne nous garantit que ces priorités systématiques soient irréformables, car, même lorsqu’elles ne sont pas directement réfutables par l’expérience, elles participent au caractère plus ou moins hypothétique et plus ou moins faillible de toute connaissance humaine. La distinction entre l’a priori et l’a posteriori est contextuelle; elle est susceptible de varier en fonction du contexte général de la science:
«La totalité de notre soi-disant connaissance ou de nos croyances, depuis les faits les plus anecdotiques de la géographie et de l’histoire jusqu’aux lois les plus profondes de la physique atomique ou même des mathématiques pures et de la logique, est une étoffe tissée par l’homme, et dont le contact avec l’expérience ne se fait qu’aux lisières. Ou, pour changer d’image, la totalité de la science est comme un champ de forces dont les conditions aux limites sont l’expérience. Un conflit avec l’expérience, se produisant à la périphérie, occasionne des réajustements à l’intérieur du champ […]. Aucune expérience particulière n’est liée à des énoncés particuliers à l’intérieur du champ sinon indirectement par des conditions d’équilibre affectant la totalité du champ»
(Quine, From a Logical Point of View, II, VI, pp.42-43).
Ainsi peut se résumer la conception philosophique à laquelle Quine a donné le nom d’empirisme relatif (Roots of Reference, III, 36, p.137 sq).
Dans son texte célèbre intitulé « Les deux dogmes de l’empirisme », Quine met en cause tout l’appareil conceptuel du positivisme logique de l’école de Vienne. Les deux dogmes critiqués sont celui de l’analyticité et celui du réductionnisme.
En vertu du premier dogme, toute connaissance est ou bien analytique ou bien fondée sur l’expérience. Il y a donc, dans cette perspective, une distinction tranchée entre jugements analytiques et jugements synthétiques. Comme les jugements analytiques sont a priori et que les jugements synthétiques sont a postenori, en vertu de leur rapport à l’expérience, il n’y a pas de place pour des jugements synthétiques a priori. Le rejet de la catégorie hybride des jugements synthétiques a priori constitue le « marqueur » le plus pertinent d’une théorie logico-empiriste. Quine va précisément attaquer le principe même de la distinction entre analytique et synthétique. Pour ce faire il va montrer que la notion d’analyticité n’est pas une notion claire et ceci grâce à des exemples de synonyme. A l’arrière-plan de cette critique se profile en fait toute une théorie de la connaissance qui, à la différence des autres théories empiristes, n’est pas « atomiste » mais se présente comme holiste. Elle appréhende de manière globale la totalité du savoir. Le contact avec l’expérience se fait à la périphérie du système, et les modifications apportées par de nouvelles données se traduisent par un réaménagement de l’ensemble, elles n’affectent pas seulement tel ou tel énoncé particulier. Dans cette perspective, la différence entre énoncés analytiques et énoncés synthétiques s’effondre.
On peut considérer que cette théorie est plus empiriste, plus « pure » que celle qui postule dans le champ de la connaissance un groupe de vérités possédant un statut les rendant tout à fait hétérogènes à l’expérience et imperméables aux modifications de l’information. C’est également la conception holiste de la connaissance qui sous-tend la critique faite par Quine de l’autre dogme de l’empirisme. Avec Duhem, Quine en effet considère que nos énoncés sur le monde ne sont pas jugés individuellement mais collectivement par le tribunal de l’expérience sensible. Il en découle que la mise en rapport d’un énoncé et d’un fait – laquelle fonde toute l’épistémologie du cercle de Vienne – perd de sa pertinence. Du coup la vérifiabilité d’un énoncé perd, elle aussi, de sa clarté et de sa pertinence.
Le fait qu’on ne puisse pas mettre en rapport un énoncé avec un fait n’est plus jugé comme signe d’absurdité ou d’absence de signification. La distinction entre vérifiable et non vérifiable est « brouillée » et, avec elle, l’existence d’une dichotomie entre des énoncés dotés de signification empirique et des énoncés vides de sens. La démarcation entre science et métaphysique, que le positivisme logique justifiait à l’aide de la dichotomie entre vérifiable et non vérifiable, doit être au moins revue et corrigée. Il faut donc chercher un autre critère de signification et tourner le dos à la thèse d’un refus de la métaphysique fondé sur un critère de signification jugé désormais insuffisant.
Ce qui est original dans la philosophie de Quine c’est qu’elle constitue une des rares tentatives pour constituer un empirisme non atomique. Sur ce point également il est à l’opposé de Carnap. Il n’est pas question pour lui en effet de procéder à une construction logique du monde à partir de données particulières -quel que puisse en être le statut. Il n’y a pas davantage à expliquer le passage de l’observation de faits particuliers à la formulation de relations nécessaires telles que les lois. Le problème de l’induction ne se pose pas d’une manière aussi aigué que chez d’autres empiristes. En fait, le mythe de la « table rase » ne hante certainement pas l’esprit de Quine. C’est que, selon lui, le problème de la connaissance est un problème de transaction avec le réel. Nous avons toujours une vision globale d’une expérience totale ; toute la question c’est de parvenir à une vision adéquate d’une expérience mieux maîtrisée.
Il est un point sur lequel la position de Quine reste dans la ligne du positivisme logique, c’est celui du critère de vérifiabilité.