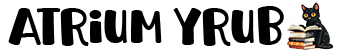Résumé libre de l’ouvrage de Jérôme Bruner: « Comment les enfants apprennent à parler », Retz, 1987
Résumé libre de l’ouvrage de Jérôme Bruner: « Comment les enfants apprennent à parler », Retz, 1987
Bruner a consacré de nombreuses années a tenté de comprendre les processus qui permettent à l’enfant d’accéder au langage et il est devenu l’un des spécialistes de la question. Pour cette raison, son ouvrage est parfois assez difficile à comprendre d’une part à cause du vocabulaire spécialisé qui y est employé et, d’autre part, parce que parfois il passe rapidement sur certain mécanisme psychologique qui ne sont pourtant pas facilement compréhensible.
« Comment les enfants apprennent à parler » est le compte-rendu de 15 ans de recherche sur le terrain. En effet, Bruner a réalisé toutes ses observations au domicile des enfants et ce afin de maintenir les petits dans un cadre familier pour ne pas que leur timidité, leur curiosité… faussent les observations.
L’ouvrage répond à une double problématique. Tout d’abord, Bruner s’intéresse à la façon dont l’entourage de l’enfant favorise les échanges langagiers de manière à lui permettre de d’abord comprendre le sens des mots puis de s’exprimer, nous verrons que c’est là le rôle du scénario. Parallèlement, il s’interroge sur les modalités de la transformation du mode de communication de l’enfant qui est d’abord gestuel avant d’être linguistique.
Cet essai est le fruit d’une recherche collective réalisée pendant de nombreuses années avec différents partenaires issues de formations différentes.
Au début des années 70, le changement d’orientation professionnelle de l’auteur est le fruit d’une évolution des mentalités. En effet, c’est à cette époque que l’étude de l’acquisition du langage s’oriente davantage vers une perspective fonctionnelle, vers l’étude d’un langage en action et elle délaisse la préoccupation liée à la maîtrise de la syntaxe et à la structure grammaticale. Bruner se sent plus proche de la nouvelle conception du langage qui émerge et il fonde un groupe de recherche pluridisciplinaire à Oxford.
Structure de l’ouvrage
Bruner a choisi de diviser son ouvrage en quatre grands chapitres. Chacun développe l’un des aspects nécessaire pour accéder au langage. Ces chapitres sont eux-mêmes sous-divisés en plusieurs parties et de nombreux exemples concrets permettent de mieux comprendre les explications théoriques. Le livre débute par une préface rédigée par J. Bruner, lui-même, où il nous explique le cheminement de sa démarche et de ses recherches qui ont abouties à la rédaction de cet essai qui fait état de sa conception de l’apprentissage du langage.
L’ouvrage est relativement court, il ne compte que 128 pages, mais son contenu très dense en fait un livre riche d’enseignement et de pistes de réflexion puisque ce que son auteur nous expose n’est pas basé sur des certitudes mais sur les conclusions qu’il tire de son travail de recherches.
Même à l’heure actuelle, près de 20 ans après la parution de l’ouvrage, aucune certitude n’existe sur la façon dont les jeunes enfants accèdent au langage et les recherches se poursuivent en suivant des pistes différentes que celles de Brunner, nous reviendrons (dans une autre page) sur ces autres pistes.
Contenu de l’ouvrage
Pour résumer le contenu de l’essai, nous reprendrons chacune des parties qui le compose afin de mettre en avant l’importance de la structure du livre car chaque chapitre apporte un élément nouveau dans la construction de la théorie de son auteur.
Dans l’introduction, Bruner tente de définir ce qu’il entend par « acquérir le langage ». En effet, ce peut être d’être capable d’énoncer quelque chose en conformité avec les règles de grammaire d’une langue mais connaître la grammaire n’est pas une fin en soi, le but est de faire quelque chose qui ait du sens. Ce peut aussi être de pouvoir se référer à quelque chose et de pouvoir signifier quelque chose ou encore d’avoir une intention de communiquer, d’avoir le pouvoir de faire quelque chose avec les mots.
Bruner pense que l’enfant doit maîtriser ces trois facettes : la syntaxe, la sémantique et la pragmatique pour être un vrai locuteur et qu’il les apprend simultanément car elles sont inséparables dans le processus d’acquisition.
Il souligne également que ces acquisitions ne pourraient se réaliser sans, d’une part, des capacités prédisposant l’enfant à parler – Noam Chomsky parle de « dispositif d’acquisition du langage » – et , d’autre part, une aide fournie par l’adulte lorsqu’il entre en relation avec l’enfant ce qui produit un « système de support pour l’acquisition du langage ».
DE LA COMMUNICATION A LA PAROLE
Tout d’abord, Bruner tente de démontrer qu’il y a des prédisposition au langage qui sont innées et obligatoires pour avoir accès à la communication verbale.
– « Une bonne part du processus cognitif à l’œuvre dans la première enfance semble destinée à soutenir des activités orientées vers un but ». Ainsi, dès le départ, les enfants manifestent une disposition active à rechercher des moyens dans la poursuite d’une fin.
– « Une part considérable de l’activité de l’enfant durant la première année et demie de sa vie est extraordinairement sociale et axée sur la communication ». En effet, très rapidement, il s’établit une réciprocité entre l’enfant et sa mère, liée à leur nombreux échanges par le regard et les mots, que le tout petit finit par désirer.
– « Une bonne part de l’action initiale du tout petit témoigne d’un degré extraordinairement élevé d’ordre et de systémisation ». Le jeu en est un exemple : un seul acte est appliqué successivement à une grande série d’objets. Par exemple, l’enfant secoue tout ce qu’il parvient à saisir.
– « Le caractère systématique des dons innées cognitifs du tout petit enfant est extraordinairement abstrait ». L’enfant a la faculté de mettre en œuvre des règles abstraites. Le langage sert à amplifier, spécifier et élargir des distinctions que l’enfant connaît déjà dans son univers.
Ces 4 dons innés cognitifs – disponibilité orientée vers les moyens et les fins, transactionnalité, systématisation et abstraction – fournissent des processus fondamentaux qui aident l’enfant à acquérir le langage.
Bruner rappelle que différente théories se sont opposées à travers les époques. La théorie de Saint Augustin selon laquelle le langage s’acquiert par l’imitation a longtemps perduré dans les esprits et c’est Noam Chomsky qui a proclamé cet ancien système obsolète. Chomsky, puis Bruner, développe l’idée selon laquelle le dispositif d’acquisition du langage donne la possibilité de dégager les règles grammaticales propres à une langue particulière et permet ainsi à l’enfant de produire tous les énoncés de cette langue. Il pense que l’acquisition de la syntaxe progresse grâce à un minimum de communication privilégiée jugée indispensable. Les seules restrictions au développement linguistique sont les limites psychiques liées à la durée limitée de l’attention, à la mémoire…
Ainsi, la compétence linguistique est présente à la naissance et s’exprime lorsque les savoir-faire indispensables sont acquis.
Le langage sert à communiquer et nous communiquons dans un but précis, pour accomplir une fonction. Par exemple, Bruner a observé une maman qui utilise la forme interrogative de deux façon : pour demander une action et pour avoir une information, l’enfant répond à chaque fois en commençant par « parce que » mais différencie manifestement la différence d’intention des deux formes d’expression. Il a donc appris les actes de parole et non pas uniquement la forme interrogative. Pour faire cette différence, il doit prendre en considération non seulement la structure de l’énoncé mais aussi les conditions qui prédominent au moment où l’énoncé est produit.
Bruner adopte une position située entre celle Saint Augustin et celle de Noam Chomsky : pour communiquer verbalement, l’enfant doit maîtriser la structure conceptuelle du monde restreinte par le langage et les conventions propres à rendre claire l’expression de ses sentiments.
Le développement du langage implique deux personnes qui négocient, le langage est abordé de manière à rendre l’interaction communicative efficace. Rapidement, l’enfant développe des moyens de signaler son attention et de réclamer de l’aide. Il saisit d’abord l’essentiel du signalement conventionnalisé de ses intentions avant de maîtriser les éléments formels du langage lexico-grammaticale.
LES ACTIVITES LUDIQUES, LES JEUX ET LE LANGAGE
Aucun animal n’utilise des jeux de l’enfance tels celui du « coucou/caché » car ces jeux dépendent dans une grande mesure de l’emploi d’échanges verbaux. Ce sont des jeux qui ne peuvent exister que là où le langage est présent.
Un jeu est, à sa façon, une petite conversation. Il fournit une occasion de maintenir son attention sur une séquence ordonnée d’événements et même un jeu routinier ne cesse de varier dans les constituants qui le composent. Bruner tente de comprendre l’importance des scénari de jeu de l’apprentissage du langage par des observation fréquentes de deux enfants.
A 7 mois, un des enfants étudié, commence à répondre à un jeu routinier et prévisible et peu de temps après il assume un rôle plus actif en essayant maladroitement de produire lui-même certaines phases du jeu. A 14 mois, les rôles sont devenus tout à fait interchangeables. Le jeu a fourni un scénario structuré auquel peuvent s’appliquer les facultés linguistiques naissantes de l’enfant. Il a appris non seulement où placer les énoncés performatifs dans la séquence mais aussi leur sens et comment les dire. Le jeu a favorisé le développement du langage et aussi la façon de gérer une interaction.
LE DEVELOPPEMENT DE LA FONCTION REFERENTIELLE
C’est le moment où l’enfant comprend que ce qui l’entoure peut être nommer, que chaque chose à un nom. Bruner tente de comprendre ce qui lie un événement référentiel introductif (quand on tente d’expliquer ce qu’on a en tête) à un épisode référentiel subséquent (quand deux individus en communication donnent une interprétation à un message).
Pour savoir comment se développe la fonction référentielle, il faut savoir comment les gens dirigent et harmonisent l’attention des uns et des autres par des moyens linguistiques. Quand l’enfant développe des notions primitives de sémantique ( c’est à dire qu’il utilise toujours le même son pour la même chose), il se met à accompagner ces gestes référentiels de désignation (tendre le doigt) par des sons puis le son se substitue au geste. Ainsi, les conventions linguistiques sont habituellement des formes initialement primitives qui se sont normalisées en se socialisant au cours des échanges.
Les jeux développent, à nouveau, des savoir-faire essentiels pour comprendre la fonction référentielle. La mise en valeur de l’objet par des vocalisations de la mère est une caractéristique des premiers mois, à l’âge où l’enfant semble le moins apte à comprendre ou à produire le langage. Une fois que l’enfant manifeste une réaction bien précise et régulière aux objets présentés chaque mère diminue sa demande d’attention. Quand le regard est facilement capté, la phase cruciale suivante commence avec l’émergence du geste de monter du doigt par l’enfant. L’enfant a vu les adultes montrer du doigt et sa faculté de comprendre ce que signifie ce geste précède sa propre production d’un mois ou deux. Dès qu’apparaît ce geste et les formes phonétiquement régulières, les mères continuent les jeux de nomination tels : « Où est le… ? », « qu’est-ce que c’est ? »… débutés quand l’enfant est tout petit mais désormais elles attendent une réponse appropriée par un geste de localisation ou un son.
Dans les années 60, on se demandait s’il fallait tenter d’interpréter le langage par une méthode d’interprétation riche, aujourd’hui il semble évident qu’il faut le faire car cela fournit des voies de communications efficaces et c’est ce qui explique l’importance des scénarii lors de l’entrée de l’enfant dans le langage.
Avec le temps, l’enfant vocalise davantage et ses vocalisations deviennent plus faciles à interpréter. Quand le parent pense que l’enfant a désormais compris que les mots ont un sens, il devient plus exigent dans ses attentes de réponses, il traite les vocalisations comme si elles signifient quelque chose où, quand elles sont trop ambiguës, comme si elles devaient signifier quelque chose.
Le parent incorpore les savoir-dire nouvellement acquis au vécu quotidien et on constate qu’ainsi l’enfant parvient à maîtriser ce qui lui est familier grâce aux occasions qu’il a de répéter et, par conséquent, de se perfectionner par des échanges routiniers dans un dialogue au schéma stable (ce que Bruner appelle les scénarii).
Durant cette période, le parent a une attitude globalement permanente et prévisible mais il élève le niveau de ses exigences dès que l’enfant montre des signes qu’il est capable de faire mieux. Le but de ce réglage est la pertinence fonctionnelle. Le parent est disposé à adapter ses réponses à son enfant dans beaucoup de cas pour parvenir à un double objectif. Tout d’abord, il veut faire comprendre qu’il y a une vocalisation type qui est exigée et cela permet à l’enfant de devenir un locuteur normal. C’est un objectif linguistique. Le second est culturel, il communique à l’enfant qu’il y a une manière normative d’instituer la référence. L’enfant doit non seulement maîtriser des modes conventionnels acceptables pour signaler son intention mais il doit intégrer la référence à sa demande.
Ainsi, cet apprentissage fournit le moyen de faire des chose avec les mots mais aussi d’agir à l’intérieur de la culture
La maîtrise de la référence par l’enfant dépend autant de sa maîtrise du discours et des règles du dialogue que de ses savoir-faire individuels pour relier les perceptions aux sons et aux représentations du monde dans sa tête. La référence naît quand l’enfant maîtrise d’une part la relation entre le signe et la chose signifiée et d’autre part les échanges avec quelqu’un d’autre pour s’assurer que la liaison établie entre signifiant et signifié est conforme aux usages des autres.
La référence linguistique n’est pas naturelle et son acceptation pose un problème psychologique : Il y a une grande différence entre devoir simplement suivre le regard de quelqu’un pour comprendre de quoi il parle et maîtriser suffisamment les références qui permettent de comprendre tout le langage (sentiments, objets non visibles…).
LE DEVELOPPEMENT DE LA DEMANDE
L’objet de la demande est d’obtenir de quelqu’un qu’il livre les biens sollicités.
Comme pour la référence, la demande débute d’une manière naturelle, l’enfant fait des gestes et vocalise d’une façon qu’on peut interpréter comme l’expression d’un besoin sans savoir précisément sur quoi il porte. Quand l’enfant est capable de signifier plus précisément ce qu’il veut, la conventionnalisation progresse à une allure bien plus rapide.
Nous pouvons résumer les grandes étapes qui marquent le développement de la demande.
Petit, l’enfant s’étire vers l’objet et tente de l’attraper par lui-même, puis ce geste est accompagné de nombreux regards vers l’adulte. Plus tard, le mouvement de saisie de l’objet se convertit en un geste visible, il n’y a plus vraiment d’effort et les sons d’efforts sont remplacés par des sons d’appels. Entre 20 et 24 mois, ce sont des combinaisons de mots qui signifient la demande (« Jean manger »). Mais c’est vers 18 mois qu’il y a un changement notable dans les sollicitations avec l’émergence de demandes concernant des objets absents et les demandes d’aide.
· Les demandes concernant des objets absents nécessitent un degré de spécification beaucoup plus important : puisque l’enfant ne peut pas montrer du doigt ce qu’il désire, il lui faut savoir le désigner nominalement suffisamment clairement.
· Les demandes d’aide pour mener à bien une action sont difficiles à formuler car l’enfant doit associer ses connaissances des relations qui lient moyens et buts avec les procédures de communication destinée à solliciter une aide. La transmission de la tâche par l’enfant se réalise de deux façons : soit en montrant ce qui ne va pas, c’est la procédure « locative », soit en proposant l’instrument indispensable pour agir, c’est la procédure « instrumentale » et elle se produit bien plus tard.
La difficulté principale est d’associer à l’avance le plan d’action requis et la demande. Souvent, l’enfant guide par étapes : « maman vient » puis « prend » en montrant un objet…
Il faut du temps pour qu’une demande d’aide s’exprime entièrement et correctement, elle revêt presque toujours une forme déclarative et elle requiert une bonne acquisition de la grammaire pour pouvoir placer dans une phrase de façon convenable l’agent, l’action, l’objet, le lieu…
Bruner lie intimement culture et langage : c’est la culture qui force l’homme à maîtriser le langage et le langage sert de support pour transmettre la culture à l’enfant. En effet, les mères en profitent pour enseigner à leurs enfants qu’une demande n’est formulée que pour des services qu’on ne peut pas se rendre à soi-même et qu’elle dépend des horaires et des conditions du moment. Toute demande ne sera pas satisfaite.
L’enfant apprend à employer le langage pour obtenir ce qu’il veut, jouer, rester en contact vocal avec son entourage… ce faisant, il apprend les contraintes qui prévalent dans sa culture et qui sont concrétisées par les restrictions et les conventions imposées par les parents.
Pour apprendre à faire une demande, il faut aussi apprendre la culture et la manière de faire des choses par le langage dans cette culture. Dans l’interaction privilégiée au début de l’apprentissage du langage, l’enfant a pour la première fois l’occasion d’interpréter les textes culturels. En apprenant comment le dire, il apprend aussi ce qui est obligatoire et ce qui est valorisé chez ceux avec qui il communique.
Les enfants commencent à employer le langage non parce qu’ils ont la faculté de la faire mais parce qu’ils en ont besoin pour obtenir certaines choses.
APPRENDRE A PARLER
La seule manière d’apprendre l’usage du langage c’est de l’utiliser pour communiquer. Le langage est un moyen systématique de communiquer avec autrui, d’affecter son comportement mais aussi le notre. Une communication réussit requiert un contexte familier pour aider le jeune partenaire à clarifier ses intentions.
La thèse centrale est qu’il existe un système de support à l’acquisition du langage qui encadre l’interaction des êtres humains de manière à aider l’aspirant au langage à en maîtriser les usages.
Les scénarii fournissent la base des actes de langage et de leur condition de validité. Un scénario est une interaction contingente puisque les réponses de chacun se révèle dépendantes d’une réponse antérieure de l’autre, il requiert au moins deux partenaires agissants.