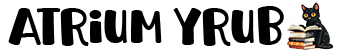ATRIUM – Histoire du Moyen Âge
Le moyen age est la période comprise entre l’Antiquité et l’Age classique, c’est-à-dire allant de la chute de l’Empire romain (en 476) à la chute de l’Empire Byzantin (en 1453). C’est l’humaniste Giovanni Andrea qui utilisa pour la première fois le terme de “Moyen age” en 1469. Mais ce n’est qu’au cours du XVIIe siècle que le mot devint d’usage courant. Il était alors utilisé dans un sens dépréciatif et désignait le millénaire séparant la disparition de la culture antique et la Renaissance.
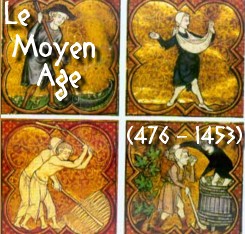
La vie intellectuelle dans les couvents
La vie intellectuelle, qui s’était éveillée à la cour de Charlemagne et dans plusieurs couvents, ne disparut ni complètement, ni partout, malgré le déclin de l’Etat et de L’Eglise. En Italie, sans doute, le Xe siècle fut une époque sombre, sans grandeur ni éclat. Peu d’écrivains mériteraient d’être nommés car on ne trouve pas un seul talent littéraire à Rome pendant toute la durée du siècle. Quelques couvents seulement, tels Bobbio et Mont Cassin, conservèrent, pour des temps meilleurs, les germes de la culture et du savoir. En revanche, la culture éclose grâce à Charlemagne et à ses acolytes survécut de remarquable façon de ce côté-ci des Alpes, en France et en Allemagne. Le nombre des gens instruits augmentait. Des moines, fuyant les Danois, vinrent, d’Angleterre et d’Ecosse, se réfugier en France; ils apportaient de nouveaux livres et de nouvelles connaissances. Et ce ne fut pas la quantité du savoir seulement qui augmenta, mais, comparé au temps de Charlemagne, le IXe siècle se signala par un goût plus fin, une plus grande maturité, plus de profondeur dans la pensée. Le travail de l’esprit ne se manifestait plus comme auparavant, par une imitation stérile dans le domaine de la poésie, ou par de vulgaires transcriptions, mais librement, sous une inspiration personnelle. La théologie passa résolument au premier plan, quoique les poètes et les écrivains païens exerçassent encore leur charme. Les moines étaient à peu près les seuls gens instruits. Les laïques qui apprenaient à lire et à écrire dans l’école d’un couvent représentaient une exception. Le bas clergé était peu instruit. Seuls, quelques évêques isolés, en France pour la plupart, se firent connaître comme écrivains; mais, d’une façon générale, ils étaient trop absorbés par les soucis de la prédication, de la guerre et de la politique pour s’adonner aux lettres. Les couvents, avec leurs écoles, furent les lieux de la contemplation et des recherches savantes, de l’enseignement et de l’étude. Les écoles épiscopales, construites à l’ombre des cathédrales, étaient organisées de la même façon que celles des couvents, mais elles leur étaient subordonnées.
L’école conventuelle enseignait les « sept arts libéraux » ou, comme les appelle l’Allemand Notker, les « sept sources de la connaissance livresque »: grammaire, dialectique (logique), rhétorique, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. La langue de cette école était le latin. Il servait à formuler non seulement l’héritage spirituel de l’antiquité, mais encore le texte de la Bible et des Pères de l’Eglise. En lisant Virgile, les écoliers des couvents s’exerçaient à comprendre le latin et voyaient éclore en eux le sens de la poésie. Cicéron était un excellent maître de rhétorique. Les plus jeunes apprenaient à comprendre et à mémoriser les psaumes, afin de pouvoir chanter dans le choeur des moines.
Le couvent de Fulda devint le foyer de culture le plus important de l’Allemagne septentrionale et moyenne, grâce à Hrabanus Maurus Alcuin (mort en 856), maître capable, fin poète, auteur de traités de théologie, que l’on a appelé le « maître d’école des Germains ». L’un des plus fameux de ses élèves, Walahfried Strabo (mort en 849) apporta l’esprit du couvent de Fulda à Reichenau, île du lac de Constance. Il manifesta son riche talent de poète dans des poèmes profanes et religieux et composa, en outre, des ouvrages théologiques d’une grande valeur.
Mais ce fut le couvent de Saint-Gall qui, depuis la fin du IXe siècle, eut l’éclat le plus brillant. Son école fut, à cette époque, la plus célèbre de toute l’Europe centrale. En fait, il dirigeait deux écoles; l’une, la plus fameuse, était à l’intérieur de ses murs et c’est elle qui valut au couvent son développement futur; l’autre, en dehors de son enceinte, rassemblait les enfants de la noblesse des environs. Quelques hommes remarquables travaillèrent là presque simultanément; ils furent professeurs, poètes et artistes et le couvent leur doit sa première floraison. Le Zurichois Ratpert (mort en 987) fut un maître infatigable, écrivit des vers en latin et en allemand et commença l’histoire de son couvent, le « Casus Sancti Galli » qui fut continuée plus tard. Avant lui, il faut nommer Notker, surnommé « le bègue », homme d’un grand talent (mort en 912), le plus grand poète et musicien d’Allemagne au début du moyen age. Il était une personnalité richement douée, pieuse et humble, s’imposant des mortifications, mais aussi joyeuse, ouverte et bienveillante.
« Le corps de Notker, non son esprit, était frêle; sa voix, non son âme, bégayait. »
(Ekkehard, « Casus Sancti Galli ».)
S’il n’a pas découvert la séquence, cette forme spéciale de la poésie spirituelle latine, qui se développa par l’introduction de diverses paroles dans la mélodie longuement étirée de l’Alléluia, puisant aux sources latines et byzantines, il a écrit des séquences qui sont les plus belles que l’on connaisse, tant par la forme que par le fond. Ainsi il éleva incomparablement cette forme du cantique et dota d’une tradition féconde la poésie et la musique. Un collègue de Notker, Tutilo, fut l’autre grand talent dont s’honora l’école de Saint-Gall dans ce temps-là. Il était remarquablement doué, et dans plus d’un domaine: peintre et sculpteur, il exécuta plusieurs images sacrées dans les églises et les couvents de nombreuses villes d’Allemagne. Il était également orfèvre et ciseleur d’ivoire. Son apport à la poésie et à la musique sont les tropes, une forme du chant d’Eglise analogue à la séquence. L’austère liturgie romaine en fut admirablement enrichie et trouva sa forme définitive. Ils furent aussi les germes féconds qui donnèrent plus tard naissance aux cantiques à plusieurs voix et à la musique profane. Mais les moines voyaient la plus haute dignité et le but dernier de l’instruction dans le service de la religion. C’est pourquoi leurs efforts avaient pour objet principal la théologie, et la philosophie, qui s’en distinguait mal encore. La théologie consistait alors dans l’étude et l’explication de la Bible et des Pères de L’Eglise. L’objet de la philosophie, tel que le concevait la logique, était la systématisation de la morale chrétienne, aidée par les données de la sagesse antique. Il n’y avait là qu’une manifestation encore bien élémentaire du savoir, mais elle eut son importance puisqu’elle introduisit la grande époque de la scolastique du haut moyen age.
Mais si le but religieux et chrétien assigné à l’enseignement était le plus élevé, il n’était cependant pas le seul. Les sciences de la nature, quoique subordonnées à la connaissance de Dieu, était en honneur et éveillaient un intérêt très vif. Sous l’influence de l’esprit humainement chrétien de l’ordre des Bénédictins, toute l’école conventuelle, riche de piété et de foi, fut ouverte à l’influence et à la joie du monde. De là, la joyeuse impulsion de la poésie, le sens de la nature, peut-être les séquences de Notker, de là aussi l’amour de la forme, manifesté dans l’art du statuaire et l’activité laborieuse dans le domaine agricole.
Les moines ont enseigné à l’Occident l’art de la plume, du pinceau et du ciseau, aussi bien que celui de l’agriculture. Dans leurs cellules, ils copiaient de gros livres dont les originaux provenaient, pour la plupart, des bibliothèques d’Italie, des couvents de Bobbio, du Mont Cassin, plus tard de Rome, de Ravenne, de Pavie. Les copistes des couvents de Saint-Martin, à Tours, et de Fleury, près d’Orléans, de Fulda et de Saint-Gall, en pays allemands, sont très renommés. En s’attaquant tout d’abord aux livres nécessaires au culte, puis à la Bible et aux oeuvres des Pères de l’Eglise, enfin aux écrivains latins, les moines se procurèrent les outils de leur enseignement et le matériel indispensable à l’expansion de l’instruction en Occident. C’est grâce aux manuscrits établis dans les couvents, dès le IXe siècle, que nous connaissons la plupart des classiques de l’antiquité. Les moines ne se contentaient pas de copier des livres avec soin, ils les ornaient. A l’époque carolingienne, l’art de la miniature fleurit dans les couvents de France, de Lorraine, à Fulda, à Saint-Gall. Les pages des manuscrits portaient des initiales, de petites images, des cadres aux vives couleurs. Le plaisir que les religieux trouvaient dans ces réalisations artistiques nous est révélé par les nombreux ivoires sculptés qui sont restés de ce temps-là: couvertures de livres, diptyques, etc., ainsi que par les reliquaires d’or et d’argent ciselés et les bijoux.
La puissance créatrice de cette époque se manifesta aussi dans de grandes constructions, quoique nous n’ayons conservé que peu de monuments de ces temps reculés. Sous l’influence des styles du Bas-Empire et de Byzance, qui s’associaient à Ravenne, on édifia en France et au nord des Alpes des églises d’une forme nouvelle qui devait évoluer, au cours du Xe siècle, dans le style dit roman.
Comme les Bénédictins voulaient se libérer le plus possible du contact avec le monde auquel des obligations matérielles les liaient, les couvents s’efforcèrent de pourvoir à leur entretien dans la plus large mesure possible. C’est pourquoi, tout couvent enferme dans son enceinte un certain nombre de bâtiments. Ce sont d’abord ceux qui forment le monastère proprement dit: église, cellules, cuisine, réfectoire, autour desquels se rangent la demeure de l’abbé, l’école, l’hospice, l’infirmerie, le jardin et le cimetière; plus loin et couvrant une aire plus vaste, s’égrènent les établissements nécessaires à la vie matérielle: ateliers, étables, greniers, boulangerie et moulin. Au IXe siècle, les religieux construisaient leur monastère de leur propres mains, défrichaient les forêts, cultivaient le sol, et, tandis que, se conformant à la tradition, ils implantaient dans le nord la vieille culture de l’Italie, ils enseignaient l’exploitation du sol aux Germains encore primitifs: l’élevage, l’arboriculture et tout l’ensemble de l’art de l’agriculteur.
Dans tout cela, la technique restait élémentaire; les IXe et Xe siècles n’ont rien su de la Science. Les masses étaient encore primitives, voir même barbares. Le moine vivait plein d’idéal, de fantaisie juvénile; la joie qu’il prenait à la vie de la nature l’orientait vers l’éternité. Il soignait avec amour le jardin du couvent, y faisait croître des plantes médicinales; mais la médecine était encore dans l’enfance, les connaissances géographiques et astronomiques toutes primitives. Il n’était pas possible, tout à la fois, de défricher la forêt vierge, de poser les fondements de l’instruction et de réaliser de grands progrès techniques. On ne peut donc blâmer l’époque pour son ignorance. La jeune civilisation occidentale demandait son droit à l’existence, tout simplement.a