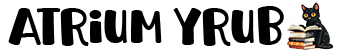Hume : Enquête sur la causalité
Parmi les études que Hume a laissées sur les diverses relations, la plus célèbre est sa critique de la causalité. La causalité devait, à vrai dire, le préoccuper particulièrement, comme semblant, dès le départ, mettre en échec son empirisme. La notion de causalité remet en effet en cause l’empirisme. Car qu’est-ce que la causalité ? Une relation entre ce qui est donné et ce qui n’est pas donné. Cette relation ne se borne pas à lier deux termes présents en notre expérience: elle amène la pensée à passer d’une cause donnée à un effet encore non donné, mais seulement attendu. Lorsque je vois la flamme, je n’ai pas besoin d’y porter la main pour savoir que si je le faisais, je me brûlerais. Faut-il donc croire qu’en ceci l’esprit, par ses seules ressources, soit capable de dépasser l’impression ? On pourrait donc se passer de l’expérience pour connaître ! Pas du tout, répond Hume. Notre philosophe va rechercher l’impression particulière dont naît l’idée de causalité. Encore faut-il savoir ce que nous entendons par causalité et ce que l’expérience nous en apprend.
Qu’avons-nous dans l’esprit quand nous parlons de causalité ? Tout d’abord un rapport spatio-temporel de contiguïté et de succession immédiate. Même quand la cause et l’effet semblent lointains et séparés, nous supposons des chaînons qui les relient: la véritable cause est donc toujours tenue pour contiguë à l’effet. Mais contiguïté n’est pas causalité: souvent un fait en précède un autre sans que nous le tenions pour sa cause. L’idée de cause est celle d’une connexion nécessaire. Donc, traditionnellement, on veut voir dans la causalité une connexion nécessaire entre la cause et l’effet : la cause étant donnée, l’effet doit s’ensuivre nécessairement. C’est la conception du rationalisme classique : l’idée de connexion nécessaire est ramenée à celle d’un rapport logique entre deux termes: la cause contient la raison suffisante de l’effet. Mais l’observation ne nous donne jamais l’idée d’un pouvoir ou d’une connexion nécessaire. Hume montre que, le phénomène cause étant seul donné, il serait impossible d’en déduire a priori l’effet: de l’idée du refroidissement de l’eau, je ne tirerai jamais l’idée de sa solidité, de sa transformation en glace. En fait, c’est entre des phénomènes hétérogènes et intellectuellement séparables que nous affirmons le lien de causalité. L’idée de cause viendrait-elle donc d’une impression objective ? Apercevrions-nous dans les choses une énergie se déployant, une force passant d’un terme à l’autre ? Il n’en est rien: jamais, dans l’objet, nous n’apercevons une telle force. Ce que nous observons, c’est le mouvement d’une boule de billard suivi du mouvement d’une autre boule. Ce que nous n’observons jamais en revanche, c’est le pouvoir contraignant par lequel la première boule obligerait la seconde à se mouvoir. Il en est de même dans nos actes volontaires : quand je lève le bras, je ne saisis jamais le pouvoir ou la force qui contraint mon bras à se lever. J’observe une volition suivie d’un mouvement corporel.
Que se passe-t-il donc dans la causalité ? À vrai dire, j’ignore tout à fait comment je puis mouvoir mes membres, et même changer le cours de mes pensées. Lorsque certains phénomènes sont invariablement suivis par d’autres phénomènes, nous avons tendance à les associer les uns aux autres. Notre croyance en la causalité ne peut donc être expliquée qu’à partir de la tendance que nous avons à passer d’un terme à l’autre. Cette tendance elle-même naît en nous de la répétition. L’expérience nous montre la constance de certaines successions, et l’habitude, qui est un principe de la nature humaine, nous détermine à attendre dans l’avenir les mêmes successions que dans le passé. Nous contractons ainsi une habitude, et nous nous attendons à voir survenir les seconds quand les premiers se produisent. Nous attribuons alors abusivement la nécessité aux objets extérieurs, alors qu’elle n’est qu’un sentiment produit en nous par l’habitude.
Il est clair, en ceci, que la causalité trouve son fondement dans le sujet: sans un sujet, et un sujet ayant une nature, la répétition n’engendrerait rien. La nature humaine devient ainsi le principe d’explication dernière des relations qui semblaient d’abord objectives. Il est à peine besoin de remarquer que, par cette théorie, la philosophie abandonne la voie de la métaphysique, qui cherchait dans l’être la source de la causalité, et s’engage dans celle qui conduira au criticisme kantien. Mais, chez Kant, le sujet qui fondera la causalité sera le sujet transcendantal. Chez Hume, c’est un sujet-nature. Non, cependant, qu’à ce niveau Hume aboutisse vraiment au scepticisme. Il remarque au contraire que sa critique ne peut ébranler notre croyance en la causalité. Car la critique ne dissout pas l’instinct: elle se contente de l’isoler, de faire évanouir l’apparence de raison qui l’entoure. L’intellectualisme une fois rejeté, un système complet de croyances peut être fondé sur le sentiment.
Une sorte d’harmonie préétablie
Ainsi, deux principes entrent en jeu dans la relation de causalité : l’expérience, c’est-à-dire l’observation des cas et de leur répétition, et l’habitude comme nous déterminant à passer de l’impression d’un objet à l’idée d’un autre et à croire que ce qui valait pour le passé vaudra pour l’avenir. Hume écrit dans le Traité de la nature humaine: « L’expérience est un principe qui m’instruit sur les diverses conjonctions des objets dans le passé. L’habitude est un autre principe qui me détermine à attendre le même dans l’avenir, les deux s’unissent pour agir sur l’imagination et ils me font former certaines idées d’une manière plus intense et plus vive que d’autres. » Qu’on pense, par exemple, à l’idée qui naît immédiatement en moi quand on dirige une épée contre ma poitrine : aussitôt ma pensée se meut vers l’idée de blessure et de douleur tout en lui transférant la force et la vivacité d’une impression présente aux sens. Par conséquent, l’entendement seul est impuissant et ne peut raisonner sur l’expérience : c’est le principe de l’habitude qui le lui permet, avec toutes les associations que nous nous sommes accoutumés à établir tout au long de notre expérience et conformément à ce principe. C’est pourquoi Hume peut dire que « l’entendement […] est fondé sur l’imagination, sur la vivacité de nos idées ».
Et puisque « l’habitude n’est rien qu’un des principes de la nature et (qu’) elle tire toute sa force de cette origine », il peut concevoir le raisonnement expérimental comme un instinct que la nature a placé en nous et que nous partageons avec les animaux. Par cet instinct « merveilleux et inintelligible », les relations que nous établissons à partir de ce qui est donné se trouvent dans un accord inattendu avec les pouvoirs cachés de la nature, ou, pour le dire autrement, la nature humaine est conforme à la Nature. « De même que la nature nous a enseigné l’usage de nos membres sans nous donner la connaissance des muscles et des nerfs qui les font agir, de même elle a implanté en nous un instinct qui emporte la pensée en avant dans un cours qui correspond à celui qu’elle a établi entre les objets extérieurs ; pourtant nous ignorons les pouvoirs et les forces dont dépendent en totalité ce cours régulier et cette succession d’objets. »
Hume rejette aussi la causalité comme fondement rationnel, comme nécessité. Pour lui, il n’y a donc rien d’absolu, ni vérité absolue, ni morale absolue ni nécessité absolue. Tout est affaire d’impressions, de sensations, d’idées, de croyances, desquelles il établit la nature et les relations. Trois conclusions, parmi d’autres, peuvent nous intéresser.
1. Les idées naissent des sensations. («Par idées, j’entends les images affaiblies des impressions dans la pensée et le raisonnement»).
2. L’habitude et l’expérience lient les idées que nous inférons de nos impressions. La croyance qui en résulte n’a pas de fondement rationnel absolu car rien ne prouve absolument que le soleil se lèvera demain. C’est évidemment très probable, mais ce n’est pas une certitude absolue. Puisque la causalité n’est qu’une croyance, il n’y a pas de cause nécessaire et partant ni métaphysique, ni preuve de Dieu par l’argument de la cause nécessaire. Au fond, toutes les croyances hors expériences sont croyances illégitimes.
3. Morale, vertu, droit et justice sont des croyances plus ou moins fondamentales, plus ou moins artificielles. La grande originalité de Hume est d’avoir insisté sur l’utilité de l’artificiel, de l’invention artificielle, qui seule permet à l’homme de dépasser la partialité de ses passions, plus néfastes que l’égoïsme pur et simple. Il s’agit donc non tant de limiter l’égoïsme de façon contractuelle que d’inventer des artifices, des conventions qui permettent aux passions de s’étendre plus loin que les parents («causes»), les amis (proches), les semblables («mêmes»), de passer ainsi d’une «sympathie limitée» à une «générosité étendue».